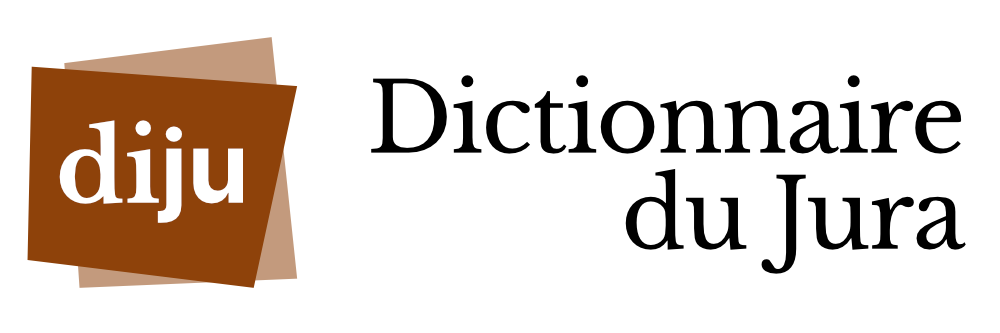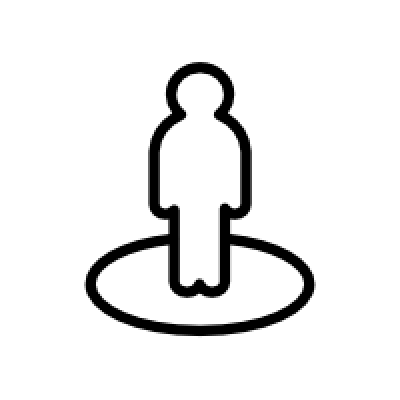Née en 1888. Décédée le 26 janvier 1959. Originaire de Triesenberg (Liechtenstein). Fille de Lydie Sele-Giauque.
Elle vit à Bienne avec sa mère, dans l'immeuble que sa famille possède au 44 de la rue Général-Dufour. Elle commence vraisemblablement à suivre des cours au début des années 1910 au Technicum de la Suisse occidentale de Bienne puis, dans la deuxième moitié des années 1910, entre à l'Ecole des Arts et Métiers de la ville de Berne afin de se former au métier d'enseignante de dessin. Elle en ressort diplômée en 1921.
Nous ne savons pas dans quel établissement elle met par la suite ses compétences à profit, mais il est possible qu'elle retourne à Bienne. Elle suit d'ailleurs probablement le même chemin que beaucoup d'artistes femmes de son époque empruntent : en parallèle de sa carrière de maîtresse de dessin, elle tente sa chance en tant qu'artiste indépendante. En ce sens, en 1928 et 1932, elle participe aux expositions de Noël de la Société des Beaux-Arts de Bienne. Ces dernières constituent en effet un excellent tremplin pour les artistes de la région, qui profitent de ces manifestations pour faire connaître leur travail1. La presse de l'époque n'évoque pourtant qu'à deux reprises la production de S., dont la présence dans les circuits officiels régionaux semble se faire rare.
Nous retrouvons sa trace bien plus tard, dans la deuxième moitié des années 1940, dans un répertoire d'artistes conservé dans les archives de la Société des Beaux-Arts de Bienne. Le manque d'information y relatif ne nous permet toutefois pas de savoir précisément s'il s'agit d'une liste de personnes membres de la Société des Beaux-Arts, ou d'artistes exposants. Quoi qu'il en soit, nous apprenons qu'entre 1947 et 1948, elle est sans emploi, sans pour autant en connaître les raisons.
A la suite de la mort de sa mère en 1945, elle continue d'habiter le même domicile. A son décès, elle lègue par testament l'ensemble de sa fortune et de ses biens à des organisations et institutions culturelles et sociales biennoises et bernoises. Sa générosité ne s'arrête pas là : on apprend aussi qu'elle lègue à la Ville de Bienne l'immeuble locatif dans lequel elle vivait, en faveur du fonds de l'établissement médico-social du Ried. Elle fait également don de différents livres à la Bibliothèque municipale de Bienne ainsi que de plusieurs dizaines de ses œuvres à la Ville de Bienne et au Musée Schwab (devenu le NMB Nouveau Musée Bienne). A ce dernier, elle lègue encore une peinture de Philippe Robert, fils de Léo-Paul Robert et Berthe Robert-de-Rutté, qu'elle possédait à titre privé, ce qui laisse supposer qu'elle était à la fois artiste et collectionneuse.
L'œuvre d'Elisabeth Sele est représentatif de celui d'une étudiante, puis d'une enseignante de dessin, car il met en exergue l'exploration de plusieurs genres - avec une prédilection pour le paysage et la nature morte - picturaux et de diverses techniques, telles que le crayon de graphite, la craie blanche, le fusain, la pierre noire, la gouache, la peinture à l'huile ou encore l'aquarelle.
Notes
- ↑ Anna Haller, Selma Rohn ou encore Betty Fankhauser y ont notamment participé en leur temps
Auteur·trice du texte original: Caroline Ferrazzo, & Coraline Gajo, 30/06/2025
Bibliographie
Le contenu de cette notice est extrait (et par endroits sensiblement adapté) de :
- Caroline Ferrazzo, & Coraline Gajo, Bienne et les arts au féminin, Orbe, Château & Attinger, 2024.
Le DIJU remercie les autrices Caroline Ferrazzo et Coraline Gajo ainsi que les éditions Château & Attinger pour leur collaboration.
Iconographie
Elisabeth Sele, [Château de Nideau], 1910, aquarelle sur papier, 42,5x55,5 cm.
Suggestion de citation
Caroline Ferrazzo, & Coraline Gajo, «Sele, Elisabeth (1888-1959)», Dictionnaire du Jura (DIJU), https://diju.ch/f/notices/detail/1004026-sele-elisabeth-1888-1959, consulté le 29/01/2026.