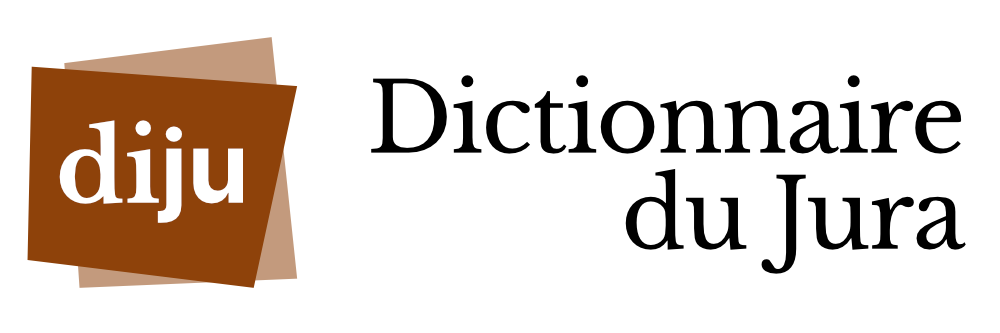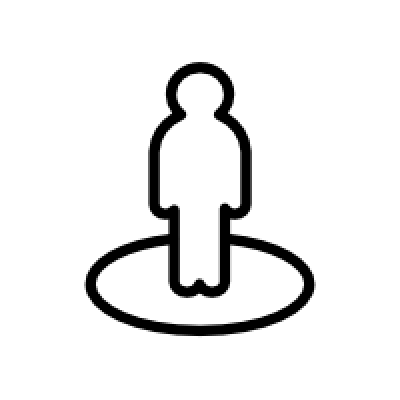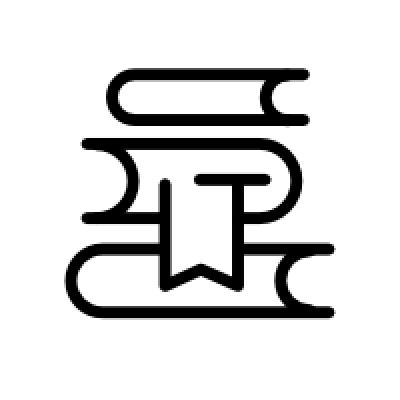Née le 17 octobre 1755 à Hambourg. Décédée le 6 mars 1806 à Strasbourg. Fille d'Albrecht Ochs (1716-1780) et de Marie Louise His (1732-1776), sœur de Peter (Pierre) Ochs (1752-1821). Epouse Philippe Frédéric de Dietrich (1748-1793) en 1772, mariage dont sont issus quatre enfants.
1755-1789
D. est membre de la famille bourgeoise Ochs de Bâle ; originaire de Freudenstadt (Bade-Wurtemberg, D), Hans Georg Ochs (1614-1680) acquiert la bourgeoisie de Bâle an 1643. Sa mère, Marie Louise, est issue d’une famille huguenote de Rouen, bien que son père Pierre His s’installe à Hambourg en 1685 et fonde la société de négoce His, qui fait faillite en 1781.
Les parents de D. se marient en 1749 ; trois ans plus tard leur fils Peter nait et Sybille suit en 1755. Les deux reçoivent une éducation humaniste et musicale, grandissent dans un environnement artistique et intellectuel à Hambourg, puis à Bâle. Préparée à son futur rôle social, D. développe très tôt un intérêt personnel pour les idées des Lumières et les enjeux sociaux .
Albert Ochs achète le Holsteinerhof à Bâle, où la famille s`installe en 1769. De plus, le mariage entre D. et Philippe Frédéric de Dietrich (1748-1793) est arrangé. Après les fiançailles en 1770, ils se marient en 1772. Le couple s`installe à Strasbourg et le 31 août 1773 nait leur premier fils, Jean Albert Frédéric, suivi par Pierre Louis Jean, né le 8 janvier 1775, et Gustave Albert, né le 21 juillet 1776. La mère de D. meurt quelques semaines seulement après la naissance de Gustave Albert.
À Paris, D. fréquente un cercle intellectuel et aristocratique lié en partie à la franc-maçonnerie et Sybille assiste probablement aux événements des loges en tant qu’invitée. Grâce à sa relation avec Joséphine de Beauharnais, D. est nommée en 1805 grande maîtresse d’une section féminine de la loge La Concorde à Strasbourg, chargée d’intégrer les « sœurs » 1.
Issu d'une famille d'industriels dans les mines de fer, Philippe Frédéric étudie la géologie, les mines et la métallurgie. Il vit et travaille ensuite à Paris, poursuit une activité scientifique et devient commissaire royal aux mines. D. le suit avec leurs enfants en 1778 et y établit elle-même un salon, ce lieu de rencontre de différentes figures de la société savante et aristocratique, comme dans leurs domaines alsaciens. La même année, la famille fait face à plusieurs tragédies : son fils Pierre Louis Jean meurt d’une fièvre scarlatine le 21 mars 1780, puis peu de temps après son père Albert Ochs décède, tout comme la grand-mère maternelle Sybille Ochs-Faesch. En 1786, les familles subissent une autre perte avec la mort de l’aïeule Louise Madeleine His.
1789-1806
D’une santé fragile, D. doit régulièrement faire face à la maladie, c’est pourquoi son mari, en tant que commissaire royal, se rend seul à Strasbourg en 1789. Après la prise de Bastille le 14 juillet, Sybille et ses enfants s’enfuient chez son frère et sa femme à Bâle. Elle s'installe à Rothau en novembre 1789 et, comme à Paris, s’engage dans les salons.
Le 19 juillet 1789, la mairie strasbourgeoise est prise, mais Philippe Frédéric peut assagir la révolte et devient maire de la ville en 1790. Claude Joseph Rouget de Lisle compose sur son ordre une chanson pour l’armée, intitulée Chant de guerre pour l’armée du Rhin, et la présente le 26 avril 1792 au maire. L’accompagnement polyphonique semble être dû à D., alors enceinte de son quatrième enfant. La chanson devient bientôt connue sous le nom de la Marseillaise2. Les bouleversements politiques et les troubles en France font que d'autres maisons dirigeantes en Europe se sentent menacées. En conséquence, les troupes des États allemand et autrichiens se trouvent aux frontières de la France en 1792 (Guerres de coalition).
Le 29 mai 1792, le quatrième fils des Dietrich voit le jour : Georges Gabriel Paul Émile – un hommage à George Washington, Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier LaFayette et Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)3.
En 1792, la Terreur conduit les Dietrich en prison. Sybille est libérée après plusieurs transferts, mais son mari est incarcéré à Paris, à l’Abbaye, où il est guillotiné le 29 décembre 1793.
Les biens de la famille sont confisqués pendant la Terreur. Si certaines biens peuvent être récupérés par la suite, les moyens financiers pour assurer la vie quotidienne, entretenir une présence en société – notamment les salons – et faire subsister les propriétés alsaciennes font cruellement défaut. D. et ses fils – surtout Fritz, l’héritier de son père – contractent des dettes considérables, aussi pour sauver et développer les forges de fer en Alsace. En même temps, Gustave Albert, qui se lance dans une carrière militaire, devient père d'une fille illégitime, Emilie, qui est recueillie par sa grand-mère Sybille.
Sybille trouve un nouvel amour avec Etienne Tardif, comte de Bordesoulle (1771-1837) pour quelques ans (1796-1800), mais la famille Dietrich empêche Sybille d'épouser l'officier. Elle doit pleurer en outre la mort de ses trois fils dans les années qui suivent : Paul Émile le 16 octobre 1799, Gustave Albert le 22 décembre 1800 et Jean Albert Frédéric le 3 février 1806. Leur mère, déjà d’une santé très fragile, ne survit à son dernier enfant qu’un mois de plus et décède le 6 mars 18064.
Notes
- ↑ Pour les discussions sur Joséphine et son acceptation en tant que franc-maçon, voir p. ex. Claude Guillon, « Joséphine de Beauharnais reçue maçonne à Lyon, en septembre 1790 (inédit) » (mise en ligne 13 février 2013 ; consulté le 5 août 2025).
- ↑ Pour les discussions sur l'origine du chant de guerre et la participation de Sybille, voir Claude Betzinger, « La Marseillaise, de Strasbourg à Paris, via Montpellier et Marseille », Revue d’Alsace [En ligne], 148 | 2022 (mis en ligne le 1er décembre 2023 ; consulté le 5 août 2025).
- ↑ Le prénom Émile renvoie au personnage central de plusieurs textes de Rousseau, notamment Émile ou De l’éducation (1762).
- ↑ L’héritage de la famille Dietrich se poursuit sous Amélie, née de Berckheim (1776–1855), veuve de « Fritz » (Jean-Frédéric), qui transforme les forges en société Veuve de Dietrich et fils en 1827. )
Auteur·trice du texte original: Nathalie Wüthrich, 11/08/2025
Bibliographie
Littérature
- Élisabeth Messmer-Hitze , Sybille de Dietrich. Une femme des Lumières en quête de liberté, Strassbourg: La Nuée Bleue (2018).
- Bettina Eichin , « Zwischen Marseillaise und Entsagung. Eine Baslerin auf dem Pfad der Aufklärung » ; in Projekt Schweiz. Vierundvierzig Porträts aus Leidenschaft (2021), S. 150-162.
- His, Eduard , Chronik der Familie Ochs, genannt His, Basel: Schwabe (1943), pp. 155-174, 177-227, 230, 236ff.
Sources en ligne
- Sarah Jenner, « Chronologie und Zeitgeschichte »; Blog: Peter Ochs und seine Zeit (s. d.) (consulté le 5 août 2025).
- Daniel Fischer, « Le parcours de sécularité d’un protestant au siècle des Lumières : Philippe Frédéric de Dietrich (1748-1793) », Revue d’Alsace [En ligne], 143 | 2017, mis en ligne le 01 septembre 2019 (consulté le 5 août 2025).
Suggestion de citation
Nathalie Wüthrich, «Dietrich, Sybille de (1755-1806)», Dictionnaire du Jura (DIJU), https://diju.ch/f/notices/detail/1004039-dietrich-sybille-de, consulté le 28/12/2025.